Once in a while, it is time to write a post in French. And this moment came today. I will discuss about dark matter, why it is needed and what is the so-called freeze-out mechanism allowing us to explain cosmological data. The English version of this post can be found here.
Je vais donc discuter, comme indiqué en anglais ci-dessus, de la matière noire et du mécanisme de freeze-out nous permettant d’expliquer les observations cosmologiques actuelles. Désolé, mais je ne traduirai pas le mot freeze-out, notamment car je ne vois pas trop comment le faire ;)
Aujourd’hui, nous avons de nombreuses preuves indirectes que la matière noire existe et a envahi tout notre univers. Ceci dit, il faut garder à l’esprit que ces preuves sont indirectes et que des alternatives à la matière noire existent.

[image credits: Wikipedia]
La quantité actuelle de matière noire dans l’univers est ce que nous appelons la densité relique de matière noire.
Il s’agit ainsi, comme on peut le deviner, du reliquat de matière noire trouvant son origine dans toutes les processus ayant eu lieu dans les premiers instants de l’univers.
Parmi tous les mécanismes expliquant pourquoi la quantité de matière noire dans l’univers est ce qu’elle est aujourd’hui, l’un de ceux les plus étudiés est le freeze-out thermique.
Mais avant de discuter cela, effectuons un petit voyage historique illustrant comment l’hypothèse de matière noire a vu le jour et pourquoi elle est toujours en vogue aujourd’hui.
LES ORIGINES DE LA MATIERE NOIRE
D’habitude, les origines de la matière noire sont placées dans les années 1930, lorsque Fritz Zwicky a introduit l’idée de la matière noire afin d’expliquer le mouvement circulaire des galaxies. Cependant, Zwicky fut loin d’être le premier à utiliser ce mot.
A la fin du 19ème siècle, les physiciens étaient déjà en train d’essayer de comprendre pourquoi les étoiles n’étaient pas distribuées de façon égale dans l’univers, mais se trouvaient regroupées en galaxies. Lord Kelvin (un gars très chaud, comprenne qui pourra :p) fut le premier à indiquer qu’il y avait quelque chose qui clochait avec la distribution des vitesses du mouvement des étoiles. Apparemment, de la masse était manquante.
Un de piliers de la physique de cette époque, Henri Poincaré, n’était absolument pas d’accord avec les conclusions de Kelvin et introduit pour la première fois les mots ‘matière noire’.
LES COURBES DE ROTATION DES GALAXIES
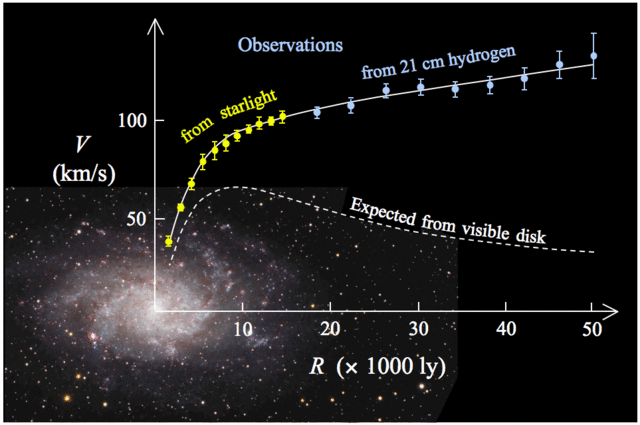
[image credits: Wikipedia]
il a cependant fallu attendre les années 1930 pour obtenir une première définition exacte du concept de matière noire comme nous le connaissons aujourd’hui.
Zwicky l’a introduit alors qu’il essayait d’expliquer le mouvement des étoiles observé dans des galaxies lointaines.
A l’aide de la mécanique classique et des lois de Newton, on peut en effet partir de la matière visible dans l’univers et prédire le mouvement des étoiles.
Zwicky a alors calculé la vitesse des étoiles et étudié le comportement de cette vitesse en fonction de l’éloignement des étoiles du centre de la galaxie. Les prédictions de Zwicky sont données par la courbe en pointillés que nous pouvons voir dans la figure ci-dessus à droite. Les mesures correspondent aux points bleus et jaunes. Il est clair que quelque chose cloche…
Il y a principalement deux façons de restaurer l’accord entre théorie et expérience.
La première d’entre elles revient à supposer l’existence de masse invisible, la matière noire, qui a un effet sur le mouvement de la matière visible. Bien que cela semble extrêmement artificiel, nous avons depuis de nombreuses preuves supplémentaires concernant son existence. Elle est effectivement également motivée par le fonds diffus cosmologique, la formation des structures de l’univers, les lentilles gravitationnelles et bien d’autres.

[image credits: NASA]
Ces preuves sont bien entendu toutes indirectes, et cela permet à des alternatives à la matière noire d’être toujours bien vivantes aujourd’hui.
Par exemple, la deuxième façon de restaurer l’accord entre données et prédictions dans la figure ci-dessus se base sur l’idée de modifier la gravité à grandes distances.
Il n’y a rien de farfelu la dedans et cela marche relativement bien. Il est cependant bon d’indiquer que l’accord avec les données cosmologiques n’est pas aussi fort qu’avec l’hypothèse de matière noire.
LE FREEZE-OUT DE LA MATIERE NOIRE
Le mécanisme du freeze-out permet d’expliquer la quantité de matière noire dans l’univers aujourd’hui. L’histoire débute aux instants primordiaux de l’univers, et on peut observer l’évolution de la densité de matière noire sur la courbe ci-dessous. Bien que cette densité évolue avec le temps, elle finit par se stabiliser et on se trouve ainsi avec une densité relique de matière noire au temps présent.

[image credits: Inspire]
Aux tous premiers instants de l’univers, on suppose un équilibre thermique où la densité de n’importe quelle particule (matière noire incluse) est égale à la densité de photons. On se trouve donc tout à gauche sur la figure.
L’équilibre vient du fait que nous avons deux réactions qui se compensent exactement:
Tout d’abord, des paires de particules de matière noire sont créees lors de la diffusion de particules plus légères très énergétiques, ce qui est possible vu la très haute température de l’univers à ce moment.
Ensuite, des paires de particules de matière noire peuvent s’annihiler en des particules plus légères.
La densité de matière noire est donc constante, vu que les pertes de matière noire sont compensées par de la création de matière noire. Cela correspond à l’horizontalité de la courbe à gauche de la figure.
Cependant, le temps passe et l’univers refroidit lors de son expansion. Par conséquent, il existe un instant où les particules plus légères ne seront plus assez énergétiques pour créer de la matière noire (plus lourde).
A partir de ce moment, seule l’annihilation de matière noire a lieu et la densité de matière noire diminue. Cette diminution peut être observée au milieu de la figure.
Mais l’univers continue à s’étendre de sorte qu’il existe un instant où la matière noire sera trop diluée pour pouvoir s’annihiler. En gros, deux particules de matière noire ne peuvent plus se rencontrer et nos deux réactions ont cessé.
La densité de matière noire devient alors constante. C’est ce qu’on appelle la densité relique de matière noire. Relique comme ‘relique des premiers instants de l’univers’. Cela correspond à la partie tout à droite de la figure, représentée par la ligne en pointillés.
La position exacte de cette ligne pointillée est dérivée des données. On dit donc que la densité de matière noire a en quelque sorte gelé, d’où le nom freeze-out.
LA VERSION COURTE
Dans ce post, j’ai discuté l’un des principaux scénarios permettant d’expliquer la quantité de matière noire présente dans l’univers aujourd’hui: le scénario du freeze-out.
Bien sûr, cela revient tout d’abord à accepter l’hypothèse de la matière noire. Comme je l’ai indiqué, cela est favorisé par les données mais les alternatives existent et sont très viables.
Ensuite, notre histoire démarre juste après le big bang, où la matière noire est très abondante. Sa densité évolue en fonction de deux processus en compétition: la production de matière noire à partir de particules plus légères et l’annihilation de matière noire en particules plus légères.
Aux premiers instants de l’univers, ces deux processus se compensent et la densité de matière noire est constante. Il existe ensuite un moment où l’univers devient trop froid (en raison de son expansion) pour que la production de matière noire ait lieu. La densité de matière noire diminue alors vu que son annihilation continue. Il existe un autre instant où la matière noire devient trop diluée dans l’univers de sorte qu’elle ne peut plus s’annihiler. La densité de matière noire redevient alors constante. On parle du freeze-out et de la densité relique de matière noire.
STEEMSTEM
SteemSTEM est un projet communautaire sur Steem qui vit depuis quasi deux ans. Nous cherchons à développer une communauté visant à promouvoir le contenu STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) et à rendre ainsi Steem plus accueillant pour ce qui touche aux champs STEM. En particulier, nous travaillons pour le moment de façon très active à implémenter sur Steem une plateforme de communication scientifique.
Plus d’informations peuvent être obtenues sur le blog de @steemstem ou de sa branche francophone @francostem, dans notre dernier rapport d’activités.